
Toute une vie ne suffit pas pour désapprendre ce que naïf, soumis, tu t’es laissé mettre dans la tête - innocent ! - sans songer aux conséquences.
Henri Michaux
Les critiques des nouvelles intelligences artificielles les accusent de ne faire que répéter bêtement ce que d'autres ont dit mais, d'une part on constate que leurs réponses ne sont pas si bêtes et, surtout, cela éveille le soupçon que nous aussi ne faisons rien d'autre que de répéter comme des perroquets ce qu'on a appris (ce qu'on appelait psittacisme), ceci sous une forme à peine personnalisée le plus souvent. Il n'y aurait pas à s'en étonner si on avait pris au sérieux ethnologie et sociologie qui prouvaient déjà le conformisme fondamental de la pensée de groupe et de l'idéologie de classe. Pourtant, la conscience de soi comme production sociale, telle que les sciences humaines l'ont mise en évidence, a toujours été minimisée (paradoxalement même par des marxistes) car réfutant les conceptions moralistes ou activistes de l'histoire avec leur idéalisation de la liberté (y compris par les révolutionnaires).
La croyance dans notre libre-arbitre, supposé échapper à la causalité, est assez délirante et d'ailleurs objet de polémiques au moins depuis Luther qui la contestait comme plus tard s'y opposera le déterminisme de Spinoza et le principe que rien n'est sans raisons. Le matérialisme historique de Marx soulignant l'importance du système de production ne faisait que renforcer ce déterminisme... avant de s'idéologiser. Le sentiment de notre liberté reste effectivement bien ancré en nous, indispensable subjectivement à l'action et pour effectuer nos choix ("Avec cette faculté d'agir en connaissance de cause et de choisir librement la conduite qu'il veut suivre, l'homme s'attribue une causalité véritable à l'égard de ses actes, il s'en reconnaît l'auteur." Lévy-Bruhl, L'idée de responsabilité p2). En fait, Norbert Elias remarquait que ce serait même la multiplication des contraintes, comme des choix auxquels l'individu se trouve confronté dans nos sociétés libérales, qui renforcerait le sentiment de son autonomie, jusqu'à l'autonomie subie parfois. On voit bien que cela ne peut signifier que cette liberté d'action serait inconditionnée, ce qui n'a aucun sens - mais ce que prétendent pourtant la plupart des philosophes, aussi bien Descartes et Kant que Kojève et Sartre.
Cette idéologie de la liberté et d'un individu qui se ferait lui-même (self made man, entièrement responsable de ce qu'il est) ne se cantonne pas cependant à la philosophie mais engage toute une conception de l'individu et de la justice à la base du libéralisme aussi bien que de la démocratie et de ses prétentions de souveraineté - exigence impossible de se soustraire à toute hétéronomie sous prétexte qu'elle n'est plus théologique. Si les Grand Modèles de Langage achèvent cette illusion de libre-arbitre et d'une pensée personnelle, c'est donc notre conception de la démocratie qu'il faudra changer, d'une prétendue légitime dictature de la majorité et d'une "volonté générale", au profit d'une démocratie des minorités et des Droits. La question métaphysique n'est pas sans conséquences politiques.






 Car la survie non plus n’est pas une fin en soi : vaut-il la peine de survivre dans "un monde transformé en hôpital planétaire, en école planétaire, en prison planétaire et où la tâche principale des ingénieurs de l’âme sera de fabriquer des hommes adaptés à cette condition" (Illich) ?
Car la survie non plus n’est pas une fin en soi : vaut-il la peine de survivre dans "un monde transformé en hôpital planétaire, en école planétaire, en prison planétaire et où la tâche principale des ingénieurs de l’âme sera de fabriquer des hommes adaptés à cette condition" (Illich) ?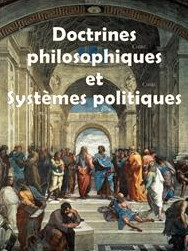







 Pic de la Mirandole (1463-1494) n'est plus guère connu que par son nom et sa prétention de couvrir tous les domaines du savoir de son époque - à seulement 24 ans - mais je me souviens avoir lu avec un certain enthousiasme le début de son
Pic de la Mirandole (1463-1494) n'est plus guère connu que par son nom et sa prétention de couvrir tous les domaines du savoir de son époque - à seulement 24 ans - mais je me souviens avoir lu avec un certain enthousiasme le début de son 

 On dira ce que
On dira ce que 
 Notre conscience morale fait sans aucun doute notre humanité, le fond des rapports humains qui occupent incontestablement une grande place dans nos vies et dans nos pensées, cependant ils ne prennent pas toute la place et il faut se garder de les idéaliser. Pour revenir à leurs limites et leur ambivalence, il suffit de faire un retour aux choses mêmes, c'est-à-dire à la vie quotidienne dans sa réalité la plus prosaïque, aussi éloignée de celle de Heidegger que de Lévinas. Ce n'est pas une peinture flatteuse (il n'y a en effet que la vérité qui blesse), mais, après le monde matériel qui nous contraint et le monde moral qui nous oblige, il reste donc à faire la phénoménologie de notre vie concrète (matière des bons romans). Il ne s'agit pas de nier les grandes émotions, les moments merveilleux ou douloureux nous faisant éprouver plus intensément le sentiment d'exister ou la présence magique de l'autre, mais la vie quotidienne que les situationnistes avaient voulu magnifier est par définition plus routinière, menacée par la lassitude et l'ennui.
Notre conscience morale fait sans aucun doute notre humanité, le fond des rapports humains qui occupent incontestablement une grande place dans nos vies et dans nos pensées, cependant ils ne prennent pas toute la place et il faut se garder de les idéaliser. Pour revenir à leurs limites et leur ambivalence, il suffit de faire un retour aux choses mêmes, c'est-à-dire à la vie quotidienne dans sa réalité la plus prosaïque, aussi éloignée de celle de Heidegger que de Lévinas. Ce n'est pas une peinture flatteuse (il n'y a en effet que la vérité qui blesse), mais, après le monde matériel qui nous contraint et le monde moral qui nous oblige, il reste donc à faire la phénoménologie de notre vie concrète (matière des bons romans). Il ne s'agit pas de nier les grandes émotions, les moments merveilleux ou douloureux nous faisant éprouver plus intensément le sentiment d'exister ou la présence magique de l'autre, mais la vie quotidienne que les situationnistes avaient voulu magnifier est par définition plus routinière, menacée par la lassitude et l'ennui.
 Depuis le romantisme, s'est constituée une utopie artistique fort peu questionnée qui se combinera aux utopies sociales, faisant de l'art la composante essentielle de l'épanouissement de l'individu, ou plutôt de l'homme total et de l'accès aux formes supérieures de la vie - ce qu'on retrouvera jusque dans les utopies numériques glorifiant la créativité et l'innovation. Dans cette préfiguration de l'existentialisme, qu'on peut définir par l'extension de l'exigence de vérité à l'existence elle-même, c'est bien un mode de vie qui est visé par la survalorisation de l'Art et de l'artiste, qui se distinguerait ainsi des animaux (et des autres hommes) par ses aspirations élevées. On peut quand même s'étonner de ces promesses publicitaires d'épanouissement de soi et de carrière artistique quand on voit la vie tourmentée des plus grands artistes ! Il y a erreur quelque part...
Depuis le romantisme, s'est constituée une utopie artistique fort peu questionnée qui se combinera aux utopies sociales, faisant de l'art la composante essentielle de l'épanouissement de l'individu, ou plutôt de l'homme total et de l'accès aux formes supérieures de la vie - ce qu'on retrouvera jusque dans les utopies numériques glorifiant la créativité et l'innovation. Dans cette préfiguration de l'existentialisme, qu'on peut définir par l'extension de l'exigence de vérité à l'existence elle-même, c'est bien un mode de vie qui est visé par la survalorisation de l'Art et de l'artiste, qui se distinguerait ainsi des animaux (et des autres hommes) par ses aspirations élevées. On peut quand même s'étonner de ces promesses publicitaires d'épanouissement de soi et de carrière artistique quand on voit la vie tourmentée des plus grands artistes ! Il y a erreur quelque part...
 La philosophie, depuis Socrate, s'oppose aussi bien au dogmatisme qu'au scepticisme comme recherche de la vérité et savoir en progrès mais le scepticisme en constitue un moment essentiel pour mettre en cause le dogmatisme qui se reconstitue sans cesse. Selon Heinz Wissmann, ce qui distinguerait la mythologie de la philosophie, ce serait que la mythologie s'arrête au principe d'oppositions de forces antagonistes quand la philosophie en cherche l'unité. On retrouverait la même distinction du monothéisme avec le dualisme manichéen, mais cela dit bien une vérité sur la tendance des philosophies et des sciences à reconstituer un système unifiant (Fichte en fait même le principe de la science). Il faut dire que, contrairement au dualisme qui se le donne au départ, l'unité supposée rend très problématique la justification du mal et du devenir, ce qui rend cette clôture dogmatique instable, simple aboutissement momentané qui sera livré à la critique d'un nouveau moment sceptique, tout comme les dogmes précédents. C'est ainsi que les sciences avancent en changeant de modèles ou de paradigmes au travers de l'histoire quand elles rencontrent des faits qui en montrent l'insuffisance. C'est ainsi que la philosophie progresse aussi, non pas une simple diversité d'opinions mais une succession de figures qui se répondent et intègrent les questions du temps.
La philosophie, depuis Socrate, s'oppose aussi bien au dogmatisme qu'au scepticisme comme recherche de la vérité et savoir en progrès mais le scepticisme en constitue un moment essentiel pour mettre en cause le dogmatisme qui se reconstitue sans cesse. Selon Heinz Wissmann, ce qui distinguerait la mythologie de la philosophie, ce serait que la mythologie s'arrête au principe d'oppositions de forces antagonistes quand la philosophie en cherche l'unité. On retrouverait la même distinction du monothéisme avec le dualisme manichéen, mais cela dit bien une vérité sur la tendance des philosophies et des sciences à reconstituer un système unifiant (Fichte en fait même le principe de la science). Il faut dire que, contrairement au dualisme qui se le donne au départ, l'unité supposée rend très problématique la justification du mal et du devenir, ce qui rend cette clôture dogmatique instable, simple aboutissement momentané qui sera livré à la critique d'un nouveau moment sceptique, tout comme les dogmes précédents. C'est ainsi que les sciences avancent en changeant de modèles ou de paradigmes au travers de l'histoire quand elles rencontrent des faits qui en montrent l'insuffisance. C'est ainsi que la philosophie progresse aussi, non pas une simple diversité d'opinions mais une succession de figures qui se répondent et intègrent les questions du temps.