Chaque élément isolé qui se montre comme condition, origine, cause d’une telle circonstance et, par conséquent, a apporté quelque chose qui lui est propre, peut être considéré comme comptable de cela, ou, au moins, comme y ayant une part de responsabilité.
Hegel, Principes de la philosophie du Droit, p150
Les deux déterminismes
Rien n'étant sans cause, il y a bien un déterminisme intégral, sauf qu'il y en a deux ! On a déjà vu qu'on ne peut, comme le prétendent des physiciens, tout réduire aux causes mécaniques, y compris la mécanique quantique. Il est absurde de parler d'une "fonction d'onde universelle" qui rendrait compte de tout ce qui arrive dans l'univers. Comme j'ai essayé de le montrer, il y a place pour une autre causalité qui n'est pas physique et s'oppose même à l'entropie universelle, c'est l'intervention du vivant et de sa part de "liberté" échappant au pur déterminisme physique, introduisant, par sélection et apprentissages, les causes finales dans la chaîne des causes. On passe ainsi d'une cause mécanique, s'épuisant dans son effet, à une cause cognitive orientée vers un but, la "liberté" ressentie n'étant que l'autonomie de mouvement et de décision, entièrement dépendante des informations disponibles et des capacités cognitives de chacun. A cause de notre finitude, au minimum l'information est toujours imparfaite et le résultat de la cognition est non seulement approximatif mais sujet à l'erreur (pour Hegel, même "l’esprit n’est que ce qu’il sait de lui-même"), sans parler de l'étendue de notre connerie humaine. Le fait qu'il soit d'un tout autre ordre que le déterminisme physique, et moins "efficace", n'empêche pas d'avoir affaire à un déterminisme aussi inévitable, combinant l'hérédité à la formation individuelle, déterminisme de sa personnalité, de ses acquis génétiques et cognitifs. On sait maintenant à quel point notre personnalité et nos actes dépendent entièrement de notre passé, de la société, des cultures dans lesquels nous avons été baignés, notre liberté se réduisant à en appliquer volontairement les normes avec un certain degré d'incertitude, comme dans la mécanique quantique. On a dans un cas comme dans l'autre un déterminisme intégrant une part d'incalculable (non pas d'indéterminisme à vrai dire impensable). Le libre-arbitre nous faisant notre propre arbitre de nos actes ne saurait être inconditionné, sans motivation, mais la plupart du temps contraint et résultant de nos représentations comme de la douleur ou du plaisir attendu.
Causalité individuelle
Cette causalité extérieure mise en évidence par les sciences sociales est loin d'être claire encore de nos jours mais avait commencé depuis la naissance de la sociologie à susciter le soupçon qu'on ne pouvait plus croire à un libre-arbitre véritable, fragilisant notamment les fondements de la Justice, obligée de tenir compte dans ses peines au moins des circonstances atténuantes jusqu'à risquer d'effacer la responsabilité individuelle. C'est contre cette excuse sociologique, accusée d'exonérer les malfrats de leurs crimes, qu'un premier ministre avait pu oser l'imbécilité de proclamer que "Expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser" ! Admettre nos déterminations sociales et intellectuelles ne fait pas disparaître pourtant la responsabilité individuelle, comme le soutenait Lucien Lévy-Bruhl dans sa thèse de 1884 sur "L'idée de responsabilité" détachée justement de la question du libre-arbitre : "Avec cette faculté d'agir en connaissance de cause et de choisir librement la conduite qu'il veut suivre, l'homme s'attribue une causalité véritable à l'égard de ses actes, il s'en reconnaît l'auteur" p2. Il faut ajouter qu'on ne peut même se dérober à notre responsabilité pour nos fautes involontaires. Ainsi un artisan est responsable de la qualité de son travail, bonne ou mauvaise. Celui dont la maladresse cause l'effondrement d'une construction a beau en être tout autant ébahi, il en reste bien responsable d'une façon ou d'une autre - et c'est une responsabilité que peut endosser tout autant une IA s'excusant effectivement de ses erreurs précédentes quand on lui fait remarquer, ayant bien une identité d'agent cognitif, admettant ainsi son erreur sans faire intervenir un quelconque libre-arbitre et encore moins des intentions mauvaises.





 Pirenne voyait dans la constitution d’un espace européen cohérent (replié sur soi), théâtre d’une période appelée « Moyen Âge », la conséquence non pas des invasions barbares (germaniques) mais de l’essor de l’Islam et de l'arrêt (relatif) des échanges entre les rives opposées de la Méditerranée.
Pirenne voyait dans la constitution d’un espace européen cohérent (replié sur soi), théâtre d’une période appelée « Moyen Âge », la conséquence non pas des invasions barbares (germaniques) mais de l’essor de l’Islam et de l'arrêt (relatif) des échanges entre les rives opposées de la Méditerranée. 
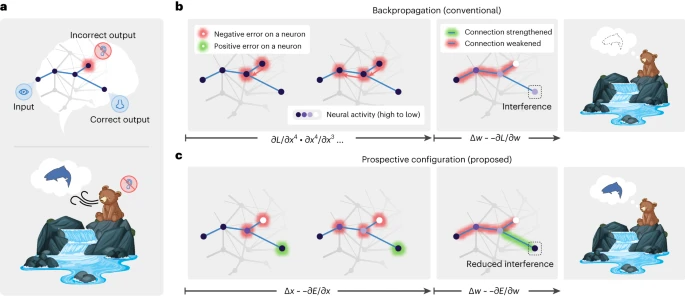


 Il y a quelques années encore, on désespérait de jamais pouvoir implanter dans un robot nos capacités langagières tant les agents conversationnels étaient limités. L'échec (relatif) du traitement du langage malgré tout ce que la linguistique croyait savoir, entretenait la croyance dans une essence mystique du langage, inaccessible à notre raison comme aux intelligences artificielles. Les performances de ChatGPT ont permis de résoudre ce dernier mystère de notre humanité (celui du langage qui nous sépare de l'animalité), en dévoilant à l'étonnement de tous son mécanisme de prédiction probabiliste de la suite, éclairant du même coup les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas l'imaginer quand nous réduisions le langage à la logique et la grammaire. Ce qui nous semblait l'essence du langage y serait seulement sous-entendu, sélection par l'usage, et ne nous est pas si naturel sous cette forme de règles plaquées de l'extérieur (ainsi on prendra un exemple avec cheval/chevaux pour savoir si on doit employer le pluriel dans une expression, sans être bien clair avec la règle elle-même). Il nous faut donc réexaminer les théories linguistiques précédentes, de Saussure à Chomsky.
Il y a quelques années encore, on désespérait de jamais pouvoir implanter dans un robot nos capacités langagières tant les agents conversationnels étaient limités. L'échec (relatif) du traitement du langage malgré tout ce que la linguistique croyait savoir, entretenait la croyance dans une essence mystique du langage, inaccessible à notre raison comme aux intelligences artificielles. Les performances de ChatGPT ont permis de résoudre ce dernier mystère de notre humanité (celui du langage qui nous sépare de l'animalité), en dévoilant à l'étonnement de tous son mécanisme de prédiction probabiliste de la suite, éclairant du même coup les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas l'imaginer quand nous réduisions le langage à la logique et la grammaire. Ce qui nous semblait l'essence du langage y serait seulement sous-entendu, sélection par l'usage, et ne nous est pas si naturel sous cette forme de règles plaquées de l'extérieur (ainsi on prendra un exemple avec cheval/chevaux pour savoir si on doit employer le pluriel dans une expression, sans être bien clair avec la règle elle-même). Il nous faut donc réexaminer les théories linguistiques précédentes, de Saussure à Chomsky.






