Temps de lecture : 20 minutesAux travailleurs du numérique.
Changer d'ère
 On en sait beaucoup moins qu'on ne croit. La pensée est lente et notre rationalité limitée. Il nous est difficile d'être nos propres contemporains et de comprendre notre actualité. Il suffit de lever la tête de son clavier pourtant pour mesurer tous les bouleversements que nous vivons. Il y en a eu d'autres, sans doute, et à chaque époque son malaise, mais ce n'est pas tout-à-fait le même à chaque fois. Ainsi, on est passé de la névrose de culpabilité à la dépression d'un individualisme exacerbé, ce qui dénote un progrès malgré tout de notre autonomie où le numérique n'est pas tout-à-fait pour rien, mais il faut bien convenir que la dématérialisation, la permanence des connexions, la rapidité des échanges ont un effet déréalisant nous précipitant dans un tout autre monde, qu'on peut trouver assez inquiétant.
On en sait beaucoup moins qu'on ne croit. La pensée est lente et notre rationalité limitée. Il nous est difficile d'être nos propres contemporains et de comprendre notre actualité. Il suffit de lever la tête de son clavier pourtant pour mesurer tous les bouleversements que nous vivons. Il y en a eu d'autres, sans doute, et à chaque époque son malaise, mais ce n'est pas tout-à-fait le même à chaque fois. Ainsi, on est passé de la névrose de culpabilité à la dépression d'un individualisme exacerbé, ce qui dénote un progrès malgré tout de notre autonomie où le numérique n'est pas tout-à-fait pour rien, mais il faut bien convenir que la dématérialisation, la permanence des connexions, la rapidité des échanges ont un effet déréalisant nous précipitant dans un tout autre monde, qu'on peut trouver assez inquiétant.
Tout ne va pas pour le mieux, non, et on n'a pas fini d'en éprouver tous les effets pervers mais le malaise est en grande partie idéologique, de ne pas arriver à lui donner sens, en plus de réelles difficultés d'adaptation à ce nouvel écosystème. Certes, le sentiment de perte n'est pas seulement celui de nos repères, de nos anciens modèles, c'est aussi la perte bien réelle de nos protections sociales aggravant douloureusement notre précarité, ainsi que l'absence de prise en compte des nouvelles conditions de production, mais cette inadaptation résulte bien d'une insuffisante compréhension des transformations en cours. Il faut dire que les changements que nous vivons sont tellement considérables qu'on peut les comparer aux débuts du Néolithique ou de l'écriture mais à une vitesse considérablement accélérée. Les anciennes idéologies sont devenues complètement obsolètes. On le sait, mais elles restent encore dominantes tout comme les institutions en place qui se révèlent tout aussi inadaptées aux conditions de l'économie immatérielle.
Non seulement nous devons subir cette inadaptation qui provoque beaucoup de souffrances et de destructions de compétences mais nous devons essuyer les plâtres d'un dur apprentissage où tous les excès et les premières illusions se confrontent au réel. On peut dire qu'on se trouve au plus mauvais moment, celui de la crise, quand une nouvelle époque tarde à naître et se peuple de monstres (délires complotistes, technophobes ou mystiques). On peut dire aussi qu'on est au moment le plus crucial, dans l'oeil du cyclone, au moment où notre voix et notre action peuvent porter le plus et décider de l'avenir.
Lire la suite
 Entre une simple réforme du capitalisme financier suite à son effondrement et le réveil des utopies métaphysiques provoquées par le caractère apocalyptique de la conjonction des crises, il y a une seule voie praticable qui est celle à la fois de la régulation globale et des alternatives locales. C'est ce qu'illustrent à merveille les monnaies locales bien que la monnaie soit si mystérieuse et difficile à penser dans ses deux faces sociales et individualisantes, témoignant de nos limites cognitives mais aussi d'une réalité plus riche et contradictoire que toutes nos théories.
Entre une simple réforme du capitalisme financier suite à son effondrement et le réveil des utopies métaphysiques provoquées par le caractère apocalyptique de la conjonction des crises, il y a une seule voie praticable qui est celle à la fois de la régulation globale et des alternatives locales. C'est ce qu'illustrent à merveille les monnaies locales bien que la monnaie soit si mystérieuse et difficile à penser dans ses deux faces sociales et individualisantes, témoignant de nos limites cognitives mais aussi d'une réalité plus riche et contradictoire que toutes nos théories.

 Quand le libéralisme triomphant nous imposait un individualisme débridé avec une conception de l'homme réduite à ses plus mauvais côtés, l'urgence était bien d'affirmer notre communauté originaire et de refonder nos solidarités sociales mais lorsque les mouvements sociaux se réveillent et qu'on assiste au retour de l'Etat, l'urgence redevient l'affirmation de la liberté individuelle et de ne pas tomber dans un angélisme destructeur mais de préserver la dualité, voire la duplicité de notre réalité humaine. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'universel qu'il n'y a pas de particulier. Il y a du collectif mais il y a aussi de l'individuel. Certes, il n'y a pas que des corps, il y a aussi les relations entre les corps mais il y a quand même la part du corps. Il n'y a pas de dignité en dehors de l'appartenance à la communauté humaine mais cette dignité réside malgré tout dans notre liberté et responsabilité individuelle ; liberté constituant l'essence même de l'amour et de ses contradictions, à mille lieues de la liberté idéalisée du libéralisme.
Quand le libéralisme triomphant nous imposait un individualisme débridé avec une conception de l'homme réduite à ses plus mauvais côtés, l'urgence était bien d'affirmer notre communauté originaire et de refonder nos solidarités sociales mais lorsque les mouvements sociaux se réveillent et qu'on assiste au retour de l'Etat, l'urgence redevient l'affirmation de la liberté individuelle et de ne pas tomber dans un angélisme destructeur mais de préserver la dualité, voire la duplicité de notre réalité humaine. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'universel qu'il n'y a pas de particulier. Il y a du collectif mais il y a aussi de l'individuel. Certes, il n'y a pas que des corps, il y a aussi les relations entre les corps mais il y a quand même la part du corps. Il n'y a pas de dignité en dehors de l'appartenance à la communauté humaine mais cette dignité réside malgré tout dans notre liberté et responsabilité individuelle ; liberté constituant l'essence même de l'amour et de ses contradictions, à mille lieues de la liberté idéalisée du libéralisme.
 Tout pourrait revenir comme avant ou presque, semble-t-il, avec quelques règles en plus, quelques ajustements, de sévères corrections même, mais tout cela n'aurait été au fond qu'un mauvais moment à passer, une simple réduction de l'activité, des bénéfices, des revenus. On nous annonce pour l'année prochaine une récession entre 1% et 5%, la belle affaire ! Pas de quoi faire un plat pour cela, chacun peut retourner à ses petites affaires et joyeuses fêtes à tous ceux qui croient au Père Noël !
Tout pourrait revenir comme avant ou presque, semble-t-il, avec quelques règles en plus, quelques ajustements, de sévères corrections même, mais tout cela n'aurait été au fond qu'un mauvais moment à passer, une simple réduction de l'activité, des bénéfices, des revenus. On nous annonce pour l'année prochaine une récession entre 1% et 5%, la belle affaire ! Pas de quoi faire un plat pour cela, chacun peut retourner à ses petites affaires et joyeuses fêtes à tous ceux qui croient au Père Noël !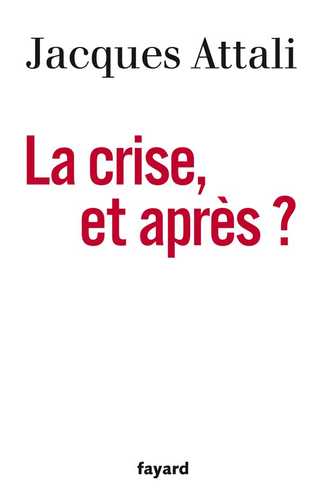 Alors qu'on s'enfonce dans la récession, que les premiers effets commencent tout juste à s'en faire sentir mais que montent déjà l'angoisse et la révolte, on aurait bien cru devoir approuver sans réserve pour une fois ce petit livre de Jacques Attali, tant l'accord peut être grand sur le diagnostic, aussi bien sur les causes que sur la gravité d'une crise qu'il avait été l'un des premiers à annoncer. Ce qui ne gâte rien, on y retrouve une rhétorique de gauche assez "percutante" (sans doute liée au fait qu'il en profite pour régler quelques comptes avec les banquiers de la City qui l'avaient obligé à démissionner de la présidence de la BERD !).
Alors qu'on s'enfonce dans la récession, que les premiers effets commencent tout juste à s'en faire sentir mais que montent déjà l'angoisse et la révolte, on aurait bien cru devoir approuver sans réserve pour une fois ce petit livre de Jacques Attali, tant l'accord peut être grand sur le diagnostic, aussi bien sur les causes que sur la gravité d'une crise qu'il avait été l'un des premiers à annoncer. Ce qui ne gâte rien, on y retrouve une rhétorique de gauche assez "percutante" (sans doute liée au fait qu'il en profite pour régler quelques comptes avec les banquiers de la City qui l'avaient obligé à démissionner de la présidence de la BERD !). Le voile se déchire, l'empire s'écroule, les fortunes se défont, les pouvoirs sont renversés ! Les belles histoires qu'on nous racontait se révèlent ce qu'elles étaient, de la pure idéologie justifiant l'injustifiable de la domination des dominants. Ce n'est pas une raison pour ne plus croire en rien ni pour croire que ce sont les idées qui mènent le monde et retomber encore une fois dans les mêmes ornières en ne faisant que passer d'une idéologie à une autre, tout aussi aveugle et barbare.
Le voile se déchire, l'empire s'écroule, les fortunes se défont, les pouvoirs sont renversés ! Les belles histoires qu'on nous racontait se révèlent ce qu'elles étaient, de la pure idéologie justifiant l'injustifiable de la domination des dominants. Ce n'est pas une raison pour ne plus croire en rien ni pour croire que ce sont les idées qui mènent le monde et retomber encore une fois dans les mêmes ornières en ne faisant que passer d'une idéologie à une autre, tout aussi aveugle et barbare.
 En toutes choses, il est bon de revenir au commencement, Ab Ovo. Le problème pour l'émergence de l'homme hors de l'animalité, c'est qu'il y a plusieurs commencements mais cela n'empêche pas qu'il est essentiel de comprendre d'où l'on vient. En particulier, contrairement à ce dont on voudrait se persuader, l'homo sapiens est loin d'avoir été non-violent, ni véritablement en harmonie avec son environnement dans les époques pré-néolithiques supposées époques d'abondance et d'an-archie.
En toutes choses, il est bon de revenir au commencement, Ab Ovo. Le problème pour l'émergence de l'homme hors de l'animalité, c'est qu'il y a plusieurs commencements mais cela n'empêche pas qu'il est essentiel de comprendre d'où l'on vient. En particulier, contrairement à ce dont on voudrait se persuader, l'homo sapiens est loin d'avoir été non-violent, ni véritablement en harmonie avec son environnement dans les époques pré-néolithiques supposées époques d'abondance et d'an-archie. Devant les malheurs du temps, il semble qu'il ne nous resterait plus qu'à rêver à quelque monde merveilleux ou alors nous raidir dans une radicalité extrême sans aucune effectivité. Tous nos murs sont couverts de promesses de bonheur en technicolor, nous croulons sous les marchandises qui voudraient maintenir notre désir en haleine, mais un certain nombre de contestataires de l'ordre établi voudraient nous persuader que leur produit est bien meilleur encore, renchérissant sur les promesses d'une jouissance supposée plus authentique celle-là, certifiée par quelques experts auto-proclamés, comme d'autres lavent plus blanc que blanc !
Devant les malheurs du temps, il semble qu'il ne nous resterait plus qu'à rêver à quelque monde merveilleux ou alors nous raidir dans une radicalité extrême sans aucune effectivité. Tous nos murs sont couverts de promesses de bonheur en technicolor, nous croulons sous les marchandises qui voudraient maintenir notre désir en haleine, mais un certain nombre de contestataires de l'ordre établi voudraient nous persuader que leur produit est bien meilleur encore, renchérissant sur les promesses d'une jouissance supposée plus authentique celle-là, certifiée par quelques experts auto-proclamés, comme d'autres lavent plus blanc que blanc ! On n'a encore rien vu de la crise économique et l'effondrement financier menace toujours mais avec l'engagement inattendu de la Chine dans un véritable New Deal et l'élection d'Obama qui devrait aller dans la même direction, l'hypothèse que la crise soit surmontée devient soudain nettement plus crédible. On n'y est pas encore, loin de là, mais il faut prendre conscience que cette crise née d'un excès de confiance dans la stabilité du système pourrait aboutir à son renforcement jusqu'à un point inégalé jusque là, achevant véritablement la globalisation marchande. On ne peut écarter la possibilité bien réelle d'une période d'instabilité géopolitique plus ou moins dévastatrice mais qui n'est pas le plus probable pour l'instant et ne ferait que reculer sans doute ce "Nouvel Ordre Mondial" qui commence à se dessiner. En tout cas, il faut envisager sérieusement que ce soit dans cet horizon, d'un système entièrement mondialisé, qu'il faudra désormais inscrire toute action politique, ce qui ne signifie pour autant ni la fin de l'histoire, ni qu'il n'y aurait plus d'alternative ! Occasion de revenir sur ce que c'est qu'un système, en quoi il nous contraint mais aussi les marges de manoeuvres qu'il nous laisse et les différents niveaux d'intervention qu'il permet, en commençant par le local.
On n'a encore rien vu de la crise économique et l'effondrement financier menace toujours mais avec l'engagement inattendu de la Chine dans un véritable New Deal et l'élection d'Obama qui devrait aller dans la même direction, l'hypothèse que la crise soit surmontée devient soudain nettement plus crédible. On n'y est pas encore, loin de là, mais il faut prendre conscience que cette crise née d'un excès de confiance dans la stabilité du système pourrait aboutir à son renforcement jusqu'à un point inégalé jusque là, achevant véritablement la globalisation marchande. On ne peut écarter la possibilité bien réelle d'une période d'instabilité géopolitique plus ou moins dévastatrice mais qui n'est pas le plus probable pour l'instant et ne ferait que reculer sans doute ce "Nouvel Ordre Mondial" qui commence à se dessiner. En tout cas, il faut envisager sérieusement que ce soit dans cet horizon, d'un système entièrement mondialisé, qu'il faudra désormais inscrire toute action politique, ce qui ne signifie pour autant ni la fin de l'histoire, ni qu'il n'y aurait plus d'alternative ! Occasion de revenir sur ce que c'est qu'un système, en quoi il nous contraint mais aussi les marges de manoeuvres qu'il nous laisse et les différents niveaux d'intervention qu'il permet, en commençant par le local. Le monde est désespérant et incompréhensible, surtout en période de crise où l'on a tant besoin de trouver des coupables, de réponses simplistes, de solutions imaginaires mais qui ne font qu'ajouter au désastre, hélas ! La difficulté de la politique c'est de ne pas tomber dans cette démagogie, dans ce qu'on voudrait bien entendre ou dans l'action purement symbolique, mais de garder le cap d'une transformation matérielle effective qui oblige à dénoncer les impasses de fausses théories et d'emportements un peu trop idéologiques.
Le monde est désespérant et incompréhensible, surtout en période de crise où l'on a tant besoin de trouver des coupables, de réponses simplistes, de solutions imaginaires mais qui ne font qu'ajouter au désastre, hélas ! La difficulté de la politique c'est de ne pas tomber dans cette démagogie, dans ce qu'on voudrait bien entendre ou dans l'action purement symbolique, mais de garder le cap d'une transformation matérielle effective qui oblige à dénoncer les impasses de fausses théories et d'emportements un peu trop idéologiques.

 La situation est grave et c'est loin d'être fini mais il faut d'autant plus raison garder : toute réussite dépend de la justesse de l'analyse. Suite à l'avalanche d'articles qui annoncent la fin du capitalisme, l'interview d'Immanuel Wallerstein dans Le Monde du 11 octobre, titré justement "
La situation est grave et c'est loin d'être fini mais il faut d'autant plus raison garder : toute réussite dépend de la justesse de l'analyse. Suite à l'avalanche d'articles qui annoncent la fin du capitalisme, l'interview d'Immanuel Wallerstein dans Le Monde du 11 octobre, titré justement "
 La crise est entrée
La crise est entrée  On en sait beaucoup moins qu'on ne croit. La pensée est lente et notre rationalité limitée. Il nous est difficile d'être nos propres contemporains et de comprendre notre actualité. Il suffit de lever la tête de son clavier pourtant pour mesurer tous les bouleversements que nous vivons. Il y en a eu d'autres, sans doute, et à chaque époque son malaise, mais ce n'est pas tout-à-fait le même à chaque fois. Ainsi, on est passé de la névrose de culpabilité à la dépression d'un individualisme exacerbé, ce qui dénote un progrès malgré tout de notre autonomie où le numérique n'est pas tout-à-fait pour rien, mais il faut bien convenir que la dématérialisation, la permanence des connexions, la rapidité des échanges ont un effet déréalisant nous précipitant dans un tout autre monde, qu'on peut trouver assez inquiétant.
On en sait beaucoup moins qu'on ne croit. La pensée est lente et notre rationalité limitée. Il nous est difficile d'être nos propres contemporains et de comprendre notre actualité. Il suffit de lever la tête de son clavier pourtant pour mesurer tous les bouleversements que nous vivons. Il y en a eu d'autres, sans doute, et à chaque époque son malaise, mais ce n'est pas tout-à-fait le même à chaque fois. Ainsi, on est passé de la névrose de culpabilité à la dépression d'un individualisme exacerbé, ce qui dénote un progrès malgré tout de notre autonomie où le numérique n'est pas tout-à-fait pour rien, mais il faut bien convenir que la dématérialisation, la permanence des connexions, la rapidité des échanges ont un effet déréalisant nous précipitant dans un tout autre monde, qu'on peut trouver assez inquiétant.